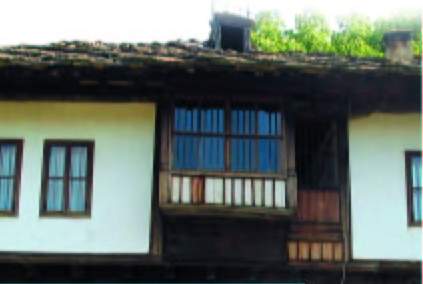 Le
nom de janvier vient du latin januarius, mois dédié à
Janus. Selon la légende, ce personnage mythologique, premier roi
du Latium, avait reçu chaleureusement le dieu de l’agriculture,
Saturne, chassé du ciel. En signe de gratitude, Saturne initie
les habitants du Latium aux travaux agricoles et donne à Janus
la faculté de sonder le passé et de prévoir l’avenir.
De là l’expression «Janus biface» et la représentation
de janvier comme un personnage
Le
nom de janvier vient du latin januarius, mois dédié à
Janus. Selon la légende, ce personnage mythologique, premier roi
du Latium, avait reçu chaleureusement le dieu de l’agriculture,
Saturne, chassé du ciel. En signe de gratitude, Saturne initie
les habitants du Latium aux travaux agricoles et donne à Janus
la faculté de sonder le passé et de prévoir l’avenir.
De là l’expression «Janus biface» et la représentation
de janvier comme un personnage
à deux visages, tournés, l’un vers l’année
écoulée, l’autre vers la nouvelle année.
1 janvier SOURVA (la Saint-Basile)
 Le
jour de l’An, fête de saint Basile, les Bulgares célèbrent
encore la Sourva (rude), allusion aux rigueurs de ce mois, le plus froid
de l’année.
Le
jour de l’An, fête de saint Basile, les Bulgares célèbrent
encore la Sourva (rude), allusion aux rigueurs de ce mois, le plus froid
de l’année.
La veille, la famille se réunit autour d’une table basse,
richement garnie des divers aliments que l’on souhaiterait avoir
en abondance pendant l’année. La maîtresse de maison
fait brûler quatre grains d’encens sur un soc de charrue et
embaume la table en faisant des gestes circulaires de gauche à
droite. Ensuite, elle fait tourner trois fois le plateau avec le feuilleté
dans lequel ont été dissimulés à l’avance
des fèves, des bourgeons de cornouiller correspondant à
un vœu, ainsi qu’une pièce en argent. Chacun s’empresse
de rompre sa part pour connaître le sort qui lui est imparti pour
la nouvelle année. Le lendemain matin, dès l’aube,
des enfants munis de rameaux de cornouiller décorés vont
d’une maison à l’autre pour présenter leurs
vœux. Ils entonnent un couplet traditionnel: Rude année, heureuse
et féconde!
Gros épis dans les champs, pommes rouges au
verger, Maïs abondant, grosses grappes au vignoble,
Maïs abondant, grosses grappes au vignoble,
Ruches pleines de miel, petits poussins partout !
Vie et santé jusqu’à l’année prochaine,
Amen !
Les enfants, nommés Sourvakari,
ponctuent leur rengaine de légères tapes dans le dos, à
l’aide des rameaux de cornouiller. Cet arbrisseau, premier à
fleurir et dernier à mûrir, est réputé pour
la dureté de son bois. Ses rameaux et leur décoration traditionnelle
sont liés à des mythes ancestraux et représentent
en miniature l’arbre universel qu’adoraient
les Protobulgares. En présentant leurs vœux, les Sourvakari
servent en quelque sorte de médiateurs entre le sacré et
le réel, de dispensateurs de fécondité. Il existe
deux types de rameaux (surovaknitsi): en tige simple taillée ou
à branches. Ces derniers sont les plus répandus et se prêtent
mieux à la décoration à l’aide de fils de laine
et de papiers multicolores, de fruits secs, de pop-corn, de graines et
de piments. A la suite des Sourvakari vient le tour des «chameliers»,
des groupes de jeunes qui passent d’une maison à l’autre,
accompagnant le mannequin d’un chameau, pour saluer les voisins
et leur souhaiter santé et abondance au
cours de l’année. Le maître chamelier prononce sa bénédiction:
Là où passe le chameau, il y aura bonheur et réussite!
Soyez solides comme l’acier
Et prolifiques comme les abeilles. Dans un deuxième temps, «le
chameau»
meurt symboliquement, comme doivent disparaître les mauvais esprits,
avant de ressusciter, comme renaît la nature pour apporter des fruits
aux humains. En échange de leur spectacle, les «chameliers»
sont invités à prendre un verre et reçoivent des
cadeaux ou de l’argent.
En Tauride (Ukraine), la nuit du passage de l’ancienne à
la nouvelle année, des jeunes gens masqués ou le visage
maculé de suie parcourent les rues et bénissent les passants
en leur souhaitant santé et prospérité.
Le 1er janvier est la fête de tous les Basile. D’origine grecque,
ce prénom signifie royal.



2 janvier: Mukovden, la fête de saint Sylvestre.
Appelé également Rinatchovden ou Karamanovden.
 La
veille au soir, les jeunes célibataires se rassemblent en bandes
pour
La
veille au soir, les jeunes célibataires se rassemblent en bandes
pour
faire le tour des maisons où habitent des jeunes filles à
marier. Il ne
s’agit pas de leur rendre visite, mais de s’illustrer comme
de
futurs bons maîtres de maison. Les jeunes entrent dans les étables
et les débarrassent du fumier qu’ils jettent dehors. Les
propriétaires prévenants ont d’avance accroché
à un clou derrière la porte un sac de provisions: des saucisses,
du lard et une gourde de vin, alors que la jeune fille y a glissé,
à l’intention de l’élu de son coeur, quelques
branches de buis, noués de fil rouge et enveloppés dans
un mouchoir multicolore, pour lui signifier qu’elle attend une proposition.
Malheur à celui qui aura oublié la récompense. Il
risque de retrouver son étable remplie du fumier des maisons voisines,
alors que sa malheureuse jeune fille, couverte de ridicule, trouvera difficilement
un candidat. Le 2 janvier est la fête des Sylvie. Ce prénom
d’origine latine signifie forêt et représente le symbole
de la nature et de la fraîcheur.
4 janvier. Fête des Tihomir.
Ce prénom, qui provient de tiho (silence), est associé à l’idée de sagesse, de grandeur et de bonheur.
 6
janvier Jordanovden, Théophanie (baptême du Christ
dans le Jourdain),
6
janvier Jordanovden, Théophanie (baptême du Christ
dans le Jourdain),
apparition de Dieu, Epiphanie chez les catholiques.
Cette fête, nommée également «Noël des
popes», est liée à la croyance dans la force
purificatrice, curative et magique de l’eau.
Le matin après la messe commence la cérémonie de
purification autour d’un point d’eau. Le prêtre lance
une croix en bois dans la rivière, le lac ou la mer et des jeunes
volontaires se jettent dans l’eau glaciale pour la repêcher.
Le premier à récupérer la croix reçoit la
bénédiction du prêtre et une petite somme d’argent.
Selon la croyance, il sera en bonne santé tout au long de l’année.
Ensuite, la fête est célébrée dans les foyers.
La table est encensée pour chasser les mauvais jours et exorciser
les mauvais esprits. C’est la fête de ceux qui portent les
prénoms de Jordan, Bogomil (cher à Dieu) et Bogdan (don
de Dieu, Dieudonné).
7 janvier La Saint-Ivan (Saint-Jean)
Dans certaines localités, dès la veille de la Saint-Jean,
après la cérémonie de purification de l’eau,
est pratiqué le rituel de la fraternisation. C’est une sorte
de serment entre deux ou trois hommes, qui se jurent fidélité
et solidarité en posant un pied nu dans la braise vive. Le témoin
de cet acte leur offre à boire une gorgée de vin rouge,
symbole du sang qui les unit à tout jamais. Ceints d’une
ceinture rouge, les
nouveaux frères de sang rompent trois pains rituels pour cimenter
l’alliance entre leurs familles. Ensuite, ils scellent leur nouvelle
parenté en dansant trois danses: la première, réservée
aux hommes, la deuxième pour les femmes et la troisième,
dansée ensemble. Désormais, les trois hommes deviennent
des frères et leurs épouses, des sœurs. Selon la tradition,
le jour de la Saint-Jean tous ceux qui portent le prénom de Jean,
Jeanette, Ivan, Vanio et autres dérivés doivent prendre
un bain, de même que les nouveaux mariés et les enfants.
Ce jour-là, l’eau, outre ses vertus purificatrices, est censée
posséder un pouvoir de consécration, car c’est également
la fête des koums (témoins de mariage), qui ont un rôle
de tout premier plan au sein de la famille bulgare. Dans certains villages,
on a coutume de baigner les gendres pour leur souhaiter une
bonne santé. Le prénom d’Ivan et ses dérivés
étant très répandus en Bulgarie, les visites familiales
à
l’occasion du jour du saint patron sont extrêmement nombreuses
ce jour-là. A noter que le prénom d’Ivan (Jean) provient
du grec Ioannis et signifie «bénédiction de dieu»
ou «dieu (vous) aide».
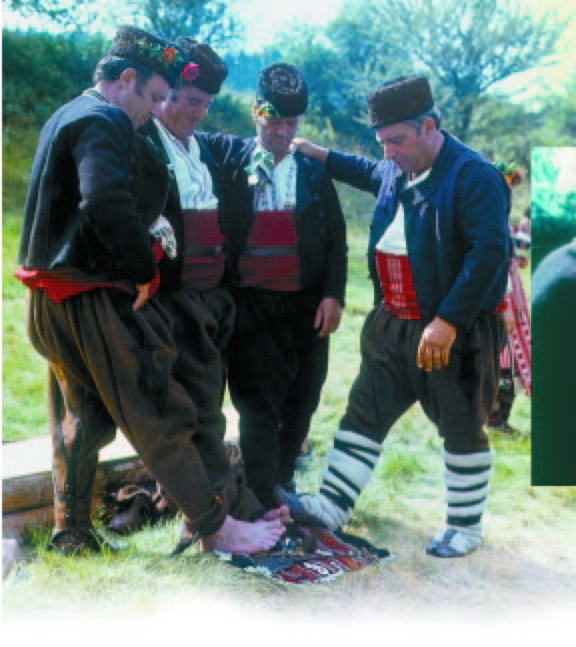

8 janvier. BABINDEN Le jour des babas (grands-mères)
Babinden, babinden n’est pas tous les jours!
Chanson populaire
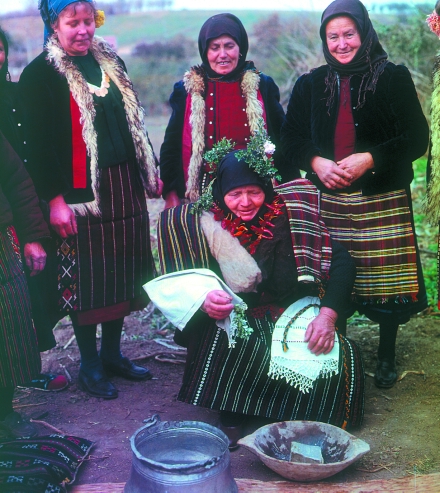


Le lendemain de la Saint-Jean est célébrée la fête
des babas. Le nom de baba est traditionnellement
donné aux femmes âgées qui, dans le passé,
exerçaient les fonctions d’accoucheuses. Ce jour-là,
les femmes se lèvent de bon matin, pour que leurs enfants soient
matinaux, et préparent des galettes. Les femmes ayant accouché
au cours de l’année, attendent la visite de la baba. En Thrace,
la baba visite dans la matinée chaque maison où elle a assisté
à la naissance d’un enfant. Elle s’assied au chevet
de l’enfant,
amorce un fil de laine rouge sur la quenouille, le torsade et le noue
au poignet droit de l’enfant «pour le maintenir en bonne santé
et le préserver des esprits malveillants». Ensuite, elle
lui lave la figure à l’eau fraîche, enduit son front
de beurre et de miel, applique dessus une touffe de laine rouge et le
bénit.
Après s’être lavé les mains à l’eau
d’un broc que lui verse la jeune maman, la baba s’essuie dans
les jupes de la femme pour faciliter ses futurs accouchements. Chaque
mère offre à la baba une pièce en argent et une quenouille
de laine; les accouchées d’un premier-né lui préparent
une brioche ronde dans le trou de
laquelle elles glissent des offrandes: une chemise, un tablier et des
bas de laine multicolores. La vraie fête commence vers midi, lorsque
toutes les femmes, portant en bandoulière des sacs en toile multicolores,
se rendent en groupes joyeux et en chantant au domicile de la baba. Avant
le repas, celle-ci encense la table et bénit l’assistance:
«Que celles qui ont accouché cette année, en fassent
autant l’année prochaine; que les pleines se vident et les
vides s’emplissent. Amen!». Les femmes miment des ablutions
avec la fumée
odorante, faisant des vœux de fécondation et de couches faciles
pendant l’année. La baba rompt le pain et en distribue à
chacune un morceau, d’après lequel est prédit le sexe
du futur bébé. Si c’est une croûte, ce sera
un garçon, si c’est une mie, ce sera une fille. Ensuite l’assistance
s’adonne a des chants, des babillages et des jeux, avant de procéder
à l’ablution rituelle de la baba. Ce jour-là, les
hommes ont intérêt à se
tenir à carreau. Il leur est interdit d’observer les réjouissances
sous peine de courroucer les femmes. Les contrevenants risquent de se
faire remplir la culotte de cailloux.
12 janvier. Fête des Tatiana, Tania. Ce prénom est dérivé d’un mot latin signifiant administratrice.
14 janvier. Fête de Nina, diminutif du prénom de Ioannina, dérivé du grec.
 17
janvier. La Saint-Antoine
17
janvier. La Saint-Antoine
Ce jour-là est chômé pour se préserver de
la
peste. Les jeunes épouses se lèvent très tôt
le
matin et préparent des galettes (tchoumini) sur
lesquelles elles étalent du miel et les distribuent
aux voisins pour souhaiter bonne santé aux
humains et au bétail. Pour conjurer la peste, ce
jour-là il est contre-indiqué de cuire des haricots,
des lentilles ou du maïs, ainsi que de tricoter ou
de coudre.
C’est la fête des Antoine, Antoinette et autres
prénoms, diminutifs ou dérivés, du latin
Antonius, qui signife inestimable.
18 janvier. La Saint-Athanase
Selon la croyance répandue en Thrace, le jour de la Saint-Athanase
l’hiver s’en va, car le saint revêt une chemise de soie,
monte sur une hauteur et s’écrie: «Va-t-en, Hiver,
viens Eté!» C’est pourquoi, ce jour-là sont
cueillis des perce-neige et des fleurs d’ellébore,
et le soleil, s’il se manifeste, apporte santé et longévité.
Dans chaque maison on prépare une galette sur laquelle on étale
du miel pour la distribuer ensuite dans les maisons du voisinage à
la santé des enfants. On tue une poule noire, sacrifiée
pour chasser la peste loin
des hommes et des animaux, mais la maîtresse de maison en garde
les plumes pour soigner les enfants et les protéger contre les
maléfices et les maladies inconnues. Les Bulgares de Bessarabie
honorent saint Athanase comme le protecteur des forgerons. Selon les mythes
païens, il est le maître des forges célestes, ami du
soleil, qui plonge ses bras nus dans le four et en extrait le métal
en
fusion. Le prénom d’Athanase vient du grec et signifie immortel.
20 janvier. La Saint-Euthyme
Ce prénom vient du grec et signifie d’humeur noble. Certains vont chercher ses origines plus anciennes dans le sanscrit où il signifie l’infini, le dieu caché.
25 janvier. La Saint-Grégoire.
Ce prénom signifie veiller, demeurer en éveil.
31 janvier. Sredzimie (la mi-hiver)
Cette fête est un vestige du Nouvel an indo-européen. En Bulgarie, elle est célébrée comme la fête des bergers, des bouviers, des porchers et des éleveurs de chevaux. Il est d’usage d’aller ramasser des feuilles d’orme sèches pour les moutons.